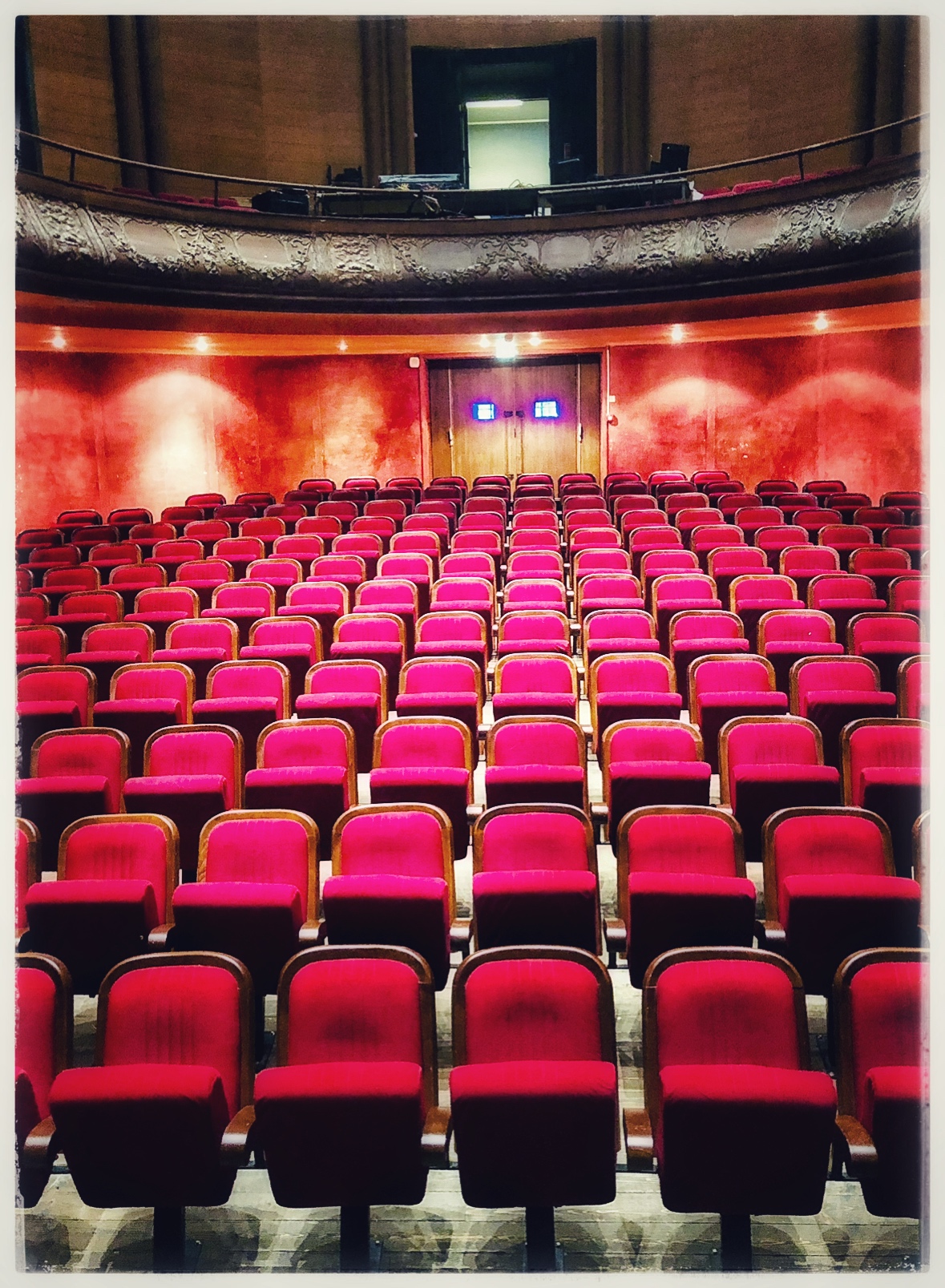C’était le début des années 80. L’époque possédait son lot de noirceur et les hommes rêvaient encore d’un monde meilleur. L’an 2000 approchait et offrait à l’humanité tout un tas de possibilités. C’était le début des années 80 et l’Homme, cet animal de génie, allait inventer tout un tas de gadgets qui lui rendraient la vie plus facile. Les voitures voleraient dans un ciel clair, nous communiquerions sans nous toucher et on trouverait ça génial ! A cette époque où un autre virus était en pleine expansion, nous avions encore foi en l’avenir.
C’était le début des années 80 et un opéra rock chantait son désespoir. Une comédie musicale affirmait que dans les villes de l’an 2000, la vie serait bien plus facile. Nous aurions tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. Vous vous souvenez probablement de ces personnages punks qui rêvaient de cultiver des tomates au soleil ou tout simplement d’être heureux avant d’être vieux.
Parmi eux, un homme solitaire criait ses frustrations au conditionnel passé. Parmi eux, un businessman avait le blues et aurait tellement voulu être autre chose qu’un instrument du capitalisme. Il avait beau avoir du succès, à la fois dans ses amours et dans les affaires, il savait bien que le bonheur ne se comptait pas en poignées de dollars, il savait bien que la vie n’aurait eu de sens que dans les arts.
J’aurais voulu être un artiste
Pour pouvoir faire mon numéro
Quand l’avion se pose sur la piste
A Rotterdam ou à Rio
En me réveillant ce matin, en 2020, je me suis demandé quel sens pourrait encore avoir cette chanson. Ce businessman dépressif aurait voulu faire rêver ses pairs et gueuler ses émotions à travers le chant, le cinéma ou l’art dramatique.
L’art dramatique…
Dramatique.
En me réveillant ce matin, je me suis dit que le monde était sens dessus dessous et qu’il ne restait aujourd’hui aux artistes que l’amère possibilité de rêver de faire du fric. Pas pour être riche. Non. Juste pour pouvoir bouffer. Dans notre sombre époque, les seuls qui peuvent encore envisager demain en toute sérénité, sont les businessmen, légitimes aux yeux du gouvernement à pouvoir exister.
J’aurais voulu être Jeff Bezos
Pour pouvoir exercer mon métier
Que l’Etat ne me ronge pas l’os
Et que j’ai le droit de travailler
Ils sont musiciens, comédiens ou danseurs. Ils sont techniciens, managers ou bookers. Intermittents ou indépendants. Hommes, femmes, tout droit sortis des jupes de maman ou ont dépassé les cinquante ans. Ils sont nos dealers de rêves, nos fenêtres ouvertes sur l’ailleurs mais dans les jours à venir, l’Etat va, à peine, rouvrir nos volets.
Moi, je ne suis pas un artiste. Je ne revendique aucun numéro, aucune scène ouverte ni aucun show. Je ne suis pas vraiment activiste ni même vaguement engagée en politique. J’appartiens aux chanceux dont le métier est considéré d’utilité publique. A juste titre, je l’entends. Mais pas moins qu’un clown qui fait rire les enfants ou qu’un slameur qui interpellerait les passants. Je suis jugée essentielle dans notre République qui hiérarchise les gens et je suis pas sûre que ça change au premier de l’an.
Je suis l’hôtesse de caisse qui scanne la bouffe derrière un plexiglas. Je suis le ripper qui vient ramasser les poubelles dégueulasses. Je suis l’infirmier qui fait ce qu’il peut pour sauver les moins chanceux. Je suis le prof qui tente encore d’accompagner nos jeunes dans un monde sans pitié. Je suis la pharmacienne de la rue d’à côté et même le SDF assis sur le banc défoncé. Je suis un humain dans toute sa simplicité et pour tenir dans ce monde insensé, j’ai besoin d’admirer les prouesses d’un équilibriste au détour d’une rue, j’ai besoin de vibrer devant la représentation d’un corps de ballet. J’ai besoin des artistes.
Dans les villes de l’an 2000, la vie est loin d’être plus facile. On a bien un numéro dans le dos, mais plus aucune étoile dans les yeux. Pour qu’un bateau avance, on a besoin de tout l’équipage, du capitaine au mec qui nettoie le fond de la cale. Pour que le monde avance, on a besoin de tous les humains, de ceux qui nous vendent du pain à ceux qui nous offrent à rêver.
Quand viendra l’an 2040, on aura soixante ans. Si on ne vit pas maintenant, demain, il sera trop tard. Ce soir, quand tout le monde dormira tranquille, je ne pourrai pas descendre sur la ville. Je ne mettrai pas le feu aux buildings ni la panique sur les boulevards. Non. Parce que j’en ai marre de rédiger des attestations. J’ai perdu le goût de la rébellion. Je ne suis pas complotiste mais force est de constater qu’ils ont muselé tous les corps de métier qui visent à nous émanciper.
Ce matin, ma fille devait réviser. Elle prépare son grand oral qu’elle fera probablement masquée. A Villequier. Victor Hugo. C’était ce poème qu’elle devait travailler. A peine éveillée et juste après mon premier café, j’ai saisi sa feuille et me suis mise à la lire à voix haute. Parce que c’est comme ça que se lisent les plus beaux textes. A peine éveillée et juste avant mon deuxième café, en déclamant Hugo, je me suis mise à pleurer. La marque de l’oreiller sur la joue, en récitant Hugo, je suis devenue artiste, c’était complètement fou. Bien-sûr, on peut me dire qu’il nous reste les livres, nos disques et même Arte TV. On peut nous dire que si on regarde bien, tout peut être matière à rêver. Mais nos artistes ont besoin de travailler et nous de nous évader.
On n’est pas heureux et on commence à en avoir l’air
On perd notre sens de l’humour depuis qu’ils marchent à l’envers
Au fond, on n’a qu’un seul regret, on vit dans un pays totalitaire.
En relisant mon texte, je me dis qu’il est peut-être décousu. Mais j’aime à penser que vous le validerez et que peut-être notre monde n’est pas encore foutu.